 Moins d'un an après la sortie de son premier album A Place Where We Could Go, qui avait suivi de moins d'un an la sortie de son premier EP pour K Records Airwalker, voici Slow Dance, le nouvel album de l'hyperatif Jeremy Jay. C'est à se demander quand le grand romantique puise son inspiration, qui semble toujours intacte. Un coup d'oeil au tracklisting et je suis ravi : on y trouve "Slow Dance" et "Breaking The Ice", deux des « tubes » qui m'ont passionné cette dernière année sur le Myspace du garçon. Alors que j'attendais ces titres, empreints de funk froid, de pop garage et de synthés new wave (qui rappellent le vide laissé par l'absence du petit génie Tom Vek), sur A Place Where We Could Go, Jeremy Jay nous avait joué des tours en sortant un album de folk-pop glam, dépourvu de tout son de synthé.
Moins d'un an après la sortie de son premier album A Place Where We Could Go, qui avait suivi de moins d'un an la sortie de son premier EP pour K Records Airwalker, voici Slow Dance, le nouvel album de l'hyperatif Jeremy Jay. C'est à se demander quand le grand romantique puise son inspiration, qui semble toujours intacte. Un coup d'oeil au tracklisting et je suis ravi : on y trouve "Slow Dance" et "Breaking The Ice", deux des « tubes » qui m'ont passionné cette dernière année sur le Myspace du garçon. Alors que j'attendais ces titres, empreints de funk froid, de pop garage et de synthés new wave (qui rappellent le vide laissé par l'absence du petit génie Tom Vek), sur A Place Where We Could Go, Jeremy Jay nous avait joué des tours en sortant un album de folk-pop glam, dépourvu de tout son de synthé. La toute première note du tout premier morceau, "We Were There" (titre déjà sorti sur EP il y a un an et demi), est bien une note de clavier ! Slow Dance s'annonce donc bien comme l'album que j'espérais ! Néanmoins, malgré ces nappes glacées à souhait, la chanson lorgne plus, dans sa structure, du côté de la pop garage sixties. Et la tendance se vérifie par la suite : "In This Lonely Town", "Canter Canter" réussissent un choc sans casse entre sons eighties et sixties. Ha ! Jeremy Jay joue toujours à cache-cache ! En effet l'artiste fait encore son timide et préfère sortir une collection de chansons garage pop plutôt que de verser franchement dans ces grooves tordus qui fascinent tant. Parce que certes, les compositions sont encore une fois excellentes (le parfait "Gallop" dénote un savoir-faire absolument indéniable), mais c'est tout de même bien, aux côtés de "Breaking The Ice", cette fameuse "Slow Dance" qui est la plus troublante. Le reste glisse sur les corps et charme très facilement.
Même si Jeremy Jay se défend de toute intention autre que d'enregistrer un album hivernal, Slow Dance montre, comme A Place Where We Could Go, une ligne directrice esthétique très forte. Il s'agit cette fois-ci d'entrechoquer les anachronismes et les températures, et de continuer à crooner avec détachement au-dessus. Et paradoxalement, c'est en jouant avec des styles depuis longtemps vulgarisés que Jeremy Jay affirme sa personnalité artistique. Il affirme sur Slow Dance son goût pour la relecture : relecture des styles, relecture du slow, mais aussi relecture de ses propres mots, de ses propres mélodies. "We Were There" revisite le "We Stay Here" du EP Airwalker, comme "Where Could We Go Tonight" revisite "A Place Where We Could Go". Et juste avant, il y a "Slow Dance 2"... Le bonheur n'est certes pas toujours absolu : ses mots manquent de façettes pour être ainsi dépliés et retournés. Et il est à vrai dire presque dommage que les ballades de fin d'album délaissent les claviers qui glacent le sang pour rejoindre l'esprit du premier album, d'autant plus que Slow Dance se révèle moins cinématographique, et donc moins inspirant que ce dernier. C'est un peu comme si Jeremy Jay avait peur de développer le son créé sur ses inédits, et ainsi de se lancer dans l'inconnu. Cependant Slow Dance continue de prouver que Jeremy Jay reste un très bon relecteur dont les histoires savent faire rêver.
En bref : Jeremy Jay ne nous livre toujours pas le petit bijou dont il est capable. Mais cette nouvelle collection, faite de guitares sixties et de synthés eighties, est une nouvelle affirmation d'une personnalité artistique très forte, dont on aimerait déjà entendre le prochain LP.

Encore une fois, je vous en prie de consulter régulièrement son Myspace, où Jeremy Jay poste d'incroyables inédits.
Aussi, Dream Diary, son blog.
A lire aussi : Jeremy Jay - A Place Where We Could Go (2008)
(Aucune vidéo n'a été mise en ligne pour ce nouvel album ; dès que ce sera fait, elle sera postée ici même.)
Lire la suite
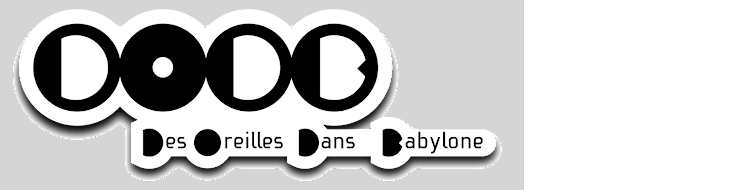





















































.jpg)





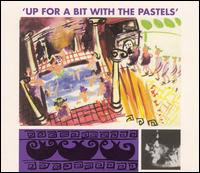








 Ca commence comme une pluie dissonante de cordes très vite suivie d'un générique façon chasse à courre : le troisième album solo de Kevin Ayers, bassiste du premier Soft Machine, s'annonce sous les meilleures auspices. Car cela n'est ni plus ni moins que deux des plus intéressants instruments de l'orchestre qu'il nous est donné d'entendre dans la majestueuse intro de "There Is Loving / Among Us / There Is Loving", le cor d'harmonie et le violoncelle. Curieux troubadour que ce Kevin Ayers, capable de décliner savamment une intro qui louche sur celles du Pink Floyd circa
Ca commence comme une pluie dissonante de cordes très vite suivie d'un générique façon chasse à courre : le troisième album solo de Kevin Ayers, bassiste du premier Soft Machine, s'annonce sous les meilleures auspices. Car cela n'est ni plus ni moins que deux des plus intéressants instruments de l'orchestre qu'il nous est donné d'entendre dans la majestueuse intro de "There Is Loving / Among Us / There Is Loving", le cor d'harmonie et le violoncelle. Curieux troubadour que ce Kevin Ayers, capable de décliner savamment une intro qui louche sur celles du Pink Floyd circa 




















