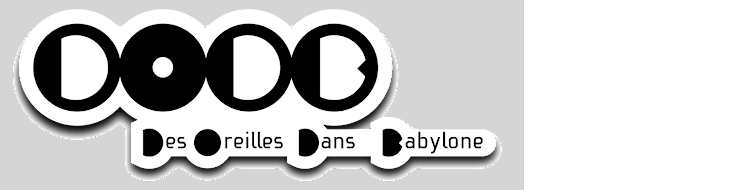4ème album des Versaillais, lancé en grandes pompes il y a quelques semaines : ce titre faussement emphatique, la promo sous forme de ballons gonflables... Et peut-être bien son meilleur. Le groupe emmené par Thomas Mars, habile chanteur qui manie plutôt bien la langue de Shakespeare, s'affirme de plus en plus comme l'un des groupes de la colonie versaillaise ou cristolienne sur lesquels compter, nos alternatives crédibles à l'éternelle hégémonie anglo-saxonne. Air avait montré la voie il y a une décennie, et depuis les Justice, Scenario Rock, Chateau Marmont, voire Poni Hoax, sans oublier les impayables et précieux Fancy, n'ont eu de cesse de tracer un nouvel axe francilien et banlieusard, qui devrait vite être pris très au sérieux par la concurrence étrangère. Et qui est sans commune mesure avec la prétendue nouvelle scène rock boutonneuse de Paname.
Phoenix, avec ses airs de ne pas y toucher, est un groupe qui fait son chemin, s'exporte très bien, et à qui on doit ce son classe un peu lounge, cette pop à la coule, bien exécutée, bien interprétée, efficace.
Ca commence avec "Lisztomania" : Franz après Amadeus, rien que de très normal ? En fait, ce qui frappe d'entrée, c'est ce mimétisme de plus en plus affirmé entre les timbres de Thomas Mars et celui de Kevin Barnes, monsieur Of Montreal en chef. Mais un Of Montreal candide, moins tordu, et qui surtout se montrerait euh... beaucoup plus abordable dans le format chanson. Candide, impavide mais inspiré, le chant ici s'accomode parfaitement de la pop langoureuse et lunaire qui l'enrobe. Peut-être moins rythmé que les précédents disques, WAM offre néanmoins de véritables petits bijoux tels que ne les renierait pas un certain Sean O'Hagan, l'homme à tout faire des High Llamas, ("1901", "Rome").
Sur la groovy "Fences" se croisent pèle-mèle, outre les rythmes chaloupés de Of Montreal, ceux de Fugu, autre trop rare orfèvre pop lorrain, drivé par l' "autre" Mehdi. Mais plusieurs plages vont même jusqu'à évoquer le Polnareff des grandes années, ce falsetto, les basses soyeuses, si le génie reclus avait troqué ses arrangements de cordes et d'orgues d'église contre l'habillage lounge poppy qui sied si bien à Phoenix.
Mais le morceau le plus surprenant demeure sans conteste ce "Love Like A Sunset" , un peu plus long que les autres, car conviant à une intro et à un break presque Kraut, où affleurent aussi le souvenir des ex-maîtres du post-rock, les Tortoise, Ui ou autres Mogwai. Tout ceci donne une première face impeccable, de celles qui feront date en 2009.
Alors, on peut sans doute regretter que le feeling, le son fluide, l'interprétation racée ne résistent pas à une deuxième moitié d'album certes jamais désagréable, mais un peu plus anecdotique. Les quatre, cinq derniers titres se ressemblent un peu tous, et un ronron finit par instants par s'installer.
Il n'empêche : pour les promesses déjà affichées, pour cette particularité "à la française" dans la production, et ce son presque immédiatement identifiable, on redemande du Phoenix, et perso, on coche déjà les dates automnales à venir dans le sud-est, et plus particulièrement celle du mois d'octobre au Rockstore de Montpellier, l'une des très nombreuses étapes d'une tournée d'importance.