 Allons, il fallait bien en parler de ce nouveau Franz Ferdinand. Même si chacun sait que les trois écossais en costumes tirés n’ont jamais récolté tous les suffrages dans nos colonnes, bien au contraire. A défaut d’en faire nos nouveaux Late Of The Pier -la place est à prendre pour 2009- laissons au troisième opus en date le bénéfice du doute, et accordons lui une écoute, juste parce que mine de rien, en 2004, il me semble que je n’étais pas le seul à danser sur "Take me out", "Auf achse" ou "Come on home". Ou alors certains ont la mémoire courte. Alors Ok, de l’eau a coulé sous les ponts et lorsqu’en 2005 sortait You could have it so much better, on aurait effectivement aimé obtenir un peu mieux que cet album bâclé, dont je ne me souviens aucun titre soit-dit-en passant. Bref, trois ans plus tard et à déjà 37 ans le bel Alex Kapranos remonte sur les planches et nous annonce quelques nouveautés. Qu’en est-il ?
Allons, il fallait bien en parler de ce nouveau Franz Ferdinand. Même si chacun sait que les trois écossais en costumes tirés n’ont jamais récolté tous les suffrages dans nos colonnes, bien au contraire. A défaut d’en faire nos nouveaux Late Of The Pier -la place est à prendre pour 2009- laissons au troisième opus en date le bénéfice du doute, et accordons lui une écoute, juste parce que mine de rien, en 2004, il me semble que je n’étais pas le seul à danser sur "Take me out", "Auf achse" ou "Come on home". Ou alors certains ont la mémoire courte. Alors Ok, de l’eau a coulé sous les ponts et lorsqu’en 2005 sortait You could have it so much better, on aurait effectivement aimé obtenir un peu mieux que cet album bâclé, dont je ne me souviens aucun titre soit-dit-en passant. Bref, trois ans plus tard et à déjà 37 ans le bel Alex Kapranos remonte sur les planches et nous annonce quelques nouveautés. Qu’en est-il ? Quelques heures plus tard -et oui, j’ai poussé le vice jusqu’à l’écouter plusieurs fois- la sensation est plutôt bonne, comme quand on vous rabâche à droite à gauche qu’un film est vraiment dégueu, et que vous ne pouvez en être finalement qu’agréablement surpris. Et malgré ce que j’ai pu lire ici ou là, Franz Ferdinand ne refait pas tout à fait du Franz Ferdinand. Alex continue d’embobiner les foules avec son faux air charmeur, Alex n’a pas perdu sa recette couplets + refrains = machines à tubes, Alex a toujours de l’énergie à revendre… Jusqu’ici tout va bien, ou mal si vous êtes définitivement allergiques. Là où interviennent les pseudos remaniements musicaux, c’est lorsque l’on voit s’effacer les traditionnelles guitares au profit d’effets samplés et de synthés, sans que cela ne ressemble de trop à ce qui se fait en ce moment. En ce sens, la nouvelle version de "Can’t stop feeling" et "Bite hard" sont surprenants.
Poussant même le bouchon un peu plus loin, le final de "Lucid dreams" est carrément électro, exempt de tous vocaux, mais finalement assez anecdotique. Par contre "What she came for" n’a pas à rougir, pas plus que "Send him away". Dans un registre plus habituel, "Live alone" ou "Ulysses" sont du Franz Ferdinand pur jus, avec tout juste un peu de synthé en sus. A écouter une fois également le synthé de "Twilight omens", pas si mauvais que ça. Les titres non cités ne recèlent quant à eux rien de remarquable, et sont à oublier dardar. Finalement plus dansant, voire plus funky (sisi) le nouveau Franz Ferdinand ne marquera pas son temps mais on ne peut lui enlever une brochette de titres festifs intercalables entres deux autres tubes plus arrosés.
En bref : Pas si mauvais que ça, le nouveau Franz Ferdinand souffre d’une concurrence actuelle bien plus inspirée mais ajoute à sa sauce un soupçon de nouveauté suffisant pour illuminer quelques morceaux récupérables.

_
_
Le site officiel et le Myspace
A lire aussi : Weezer - (2008)
"Bite hard" en live, plutôt qu’ "Ulysses" que l’on voit partout :
Lire la suite






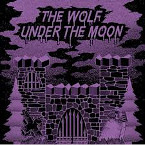
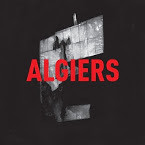
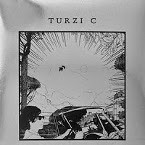
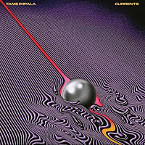



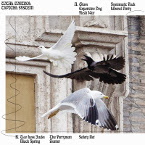


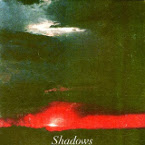
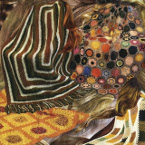


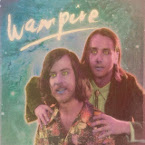



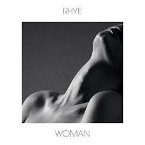
























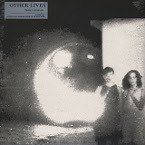
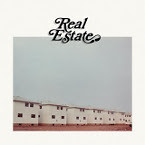
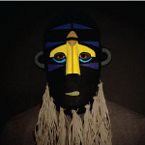


 Deuxième tuerie retenue de ma phénoménale soirée revival 80’s d’il y a quinze jours, ce maxi sorti de nulle part, enfin si, de Virginie pour être exact, et pour lequel il m’a été difficile de trouver des infos. Parce qu’avec trois lettres comme seules indications, il a fallu ruser. Mais tirons dès à présent les choses au clair. VCR est donc un groupe contemporain, fondé en 2002, dont le line-up particulier n’a cessé de se remodeler depuis. Si Chad Middleton, Steve Smith et Christian Newby font toujours partie de l’équipe, Casey Tomlin et Mya Anitai, pourtant indispensables sur cet Ep, auraient quelque peu splitté comme on dit. Bref, vous commencez à vous demander quelle est la particularité de cette obscure formation en mouvement. Et bien tout tient dans sa composition, inhabituelle chez un combo électro punk rock : pas de guitares (tout juste une basse), une batterie et trois synthés en action. Alors Ok, ça n’est pas nouveau, Devo, Depeche Mode, OMD ou encore plus récemment The Faint s’y sont essayé, mais de nos jours c’est plutôt rare. Surtout pour des morceaux qualifiés par les intéressés de fun-core aventureux, qui donnent une pêche, mais alors une pêche…
Deuxième tuerie retenue de ma phénoménale soirée revival 80’s d’il y a quinze jours, ce maxi sorti de nulle part, enfin si, de Virginie pour être exact, et pour lequel il m’a été difficile de trouver des infos. Parce qu’avec trois lettres comme seules indications, il a fallu ruser. Mais tirons dès à présent les choses au clair. VCR est donc un groupe contemporain, fondé en 2002, dont le line-up particulier n’a cessé de se remodeler depuis. Si Chad Middleton, Steve Smith et Christian Newby font toujours partie de l’équipe, Casey Tomlin et Mya Anitai, pourtant indispensables sur cet Ep, auraient quelque peu splitté comme on dit. Bref, vous commencez à vous demander quelle est la particularité de cette obscure formation en mouvement. Et bien tout tient dans sa composition, inhabituelle chez un combo électro punk rock : pas de guitares (tout juste une basse), une batterie et trois synthés en action. Alors Ok, ça n’est pas nouveau, Devo, Depeche Mode, OMD ou encore plus récemment The Faint s’y sont essayé, mais de nos jours c’est plutôt rare. Surtout pour des morceaux qualifiés par les intéressés de fun-core aventureux, qui donnent une pêche, mais alors une pêche… 































